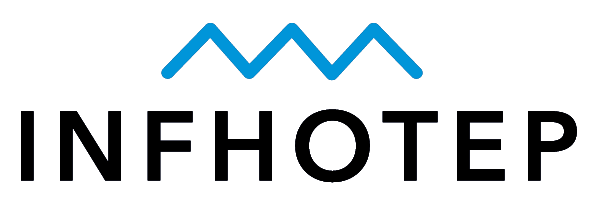Numérique responsable : Collectivités, êtes-vous prêtes pour le 1er janvier 2023 ?
Le numérique responsable est une démarche qui consiste à adapter les pratiques liées au numérique afin de réduire l’empreinte carbone qu’elles génèrent, et à garantir des valeurs sociales et d’inclusion, afin de maîtriser leur impact sur l’environnement mais aussi sur les êtres humains.
En effet, le numérique est responsable de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre selon plusieurs études. Près de 80% de l’empreinte carbone du numérique est imputable aux terminaux (smartphones, ordinateurs, tablettes, écrans). Son impact écologique n’est plus à démontrer (extraction de métaux rares, explosion de la consommation d’énergie, etc.) et de nombreux rapports et études ont été publiés ces dernières années : Shift Project, Green IT, Sénat ou encore ARCEP, le constat est présent et il s’agit aujourd’hui d’agir.
Un encadrement juridique de plus en plus contraignant pour les collectivités
Le rapport du Sénat a d’ailleurs été prolifique puisqu’il a abouti à la rédaction d’une proposition de loi, qui a finalement été adoptée par le Parlement le 2 novembre dernier, appelée loi REEN ( loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique)).
Jusque-là, l’obligation la plus structurante reposait sur l’article L229-25 du code de l’environnement, qui oblige les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants à effectuer un bilan d’émissions à effet de serre et d’élaborer un plan de transition pour réduire ces dernières. Le bilan et le plan sont à mettre à jour tous les trois ans. Le non-respect de ces obligations expose tout de même les contrevenants à une amende qui ne pourra dépasser les 10 000 € et 20 000 € en cas de récidive.
La loi REEN a introduit plusieurs articles qui peuvent retenir l’attention des collectivités :
- L’article 15 de la loi REEN modifie l’article 55 de la loi de 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire en ajoutant qu’à compter du 1er janvier 2023, l’achat public des produits informatiques des acteurs publics devra tenir obligatoirement compte de l’indice de réparabilité. En 2026, l’indice de durabilité du matériel devra également être ajouté aux critères de choix au moment de l’achat.
- L’article 16 précise que les équipements informatiques fonctionnels dont les administrations publiques se séparent doivent être orientés vers la réutilisation ou le réemploi. La cession du matériel peut se faire à des organismes tels que les associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général. Si ces équipements ont plus de dix ans, ils devront être recyclés.
- L’article 35 indique que les communes de plus de 50 000 habitants définissent, au plus tard le 1er janvier 2025, une stratégie numérique responsable qui indique notamment les objectifs de réduction de l’empreinte environnementale du numérique et les mesures mises en place pour les atteindre. Elles élaborent, au plus tard le 1er janvier 2023, un programme de travail préalable à l’élaboration de la stratégie, qui comporte notamment un état des lieux recensant les acteurs concernés et rappelant, le cas échéant, les mesures menées pour réduire l’empreinte environnementale du numérique.
Ce dernier article a été complété par un décret le 29 juillet, qui précise (de façon tout de même relative) le contenu de cette stratégie et les modalités de son élaboration. Ainsi, le programme de travail comprend :
- un bilan de l’impact environnemental du numérique et celui de ses usages sur le territoire concerné.
- Une description, sous forme de synthèse, des actions déjà engagées pour l’atténuer le cas échéant.
Sur la base de ce travail, la stratégie numérique responsable comprend :
- les objectifs de réduction de l’empreinte numérique du territoire concerné,
- les indicateurs de suivi associés à ces objectifs,
- les mesures mises en place pour y parvenir.
Ces objectifs et les mesures mises en œuvre peuvent avoir un caractère annuel ou pluriannuel. Plusieurs exemples d’objectifs sont cités pour cette stratégie : la commande publique locale et durable, dans une démarche de réemploi, de réparation et de lutte contre l’obsolescence ; la gestion durable et de proximité du cycle de vie du matériel informatique, l’écoconception des sites et des services numériques, la mise en place d’une politique de sensibilisation au numérique responsable et à la sécurité informatique à destination des élus et agents publics, …
Des référentiels pour cadrer sa démarche
Le 1er janvier 2023, c’est demain ! D’ici là, les grandes collectivités vont devoir se mettre en ordre de marche pour réaliser un bilan de l’impact environnemental du numérique et celui de ses usages sur le territoire, ce qui est déjà un large programme. Les termes utilisés étant assez flous, il pourra sans doute s’agir d’un simple recensement des impacts du numérique (utilisation de ressources et d’énergie pour 500 ordinateurs et 300 smartphones par exemple), car la réalisation d’un vrai bilan de l’impact environnemental, chiffré, demande du temps et des ressources.
Une fois le bilan réalisé, il s’agira de passer aux actions. Mais par où commencer ? Les collectivités peuvent s’appuyer sur le référentiel de l’INR qui est un document de référence pour élaborer leurs stratégies, au travers de 5 axes et 16 principes d’actions pour les collectivités. La Mission interministérielle pour le numérique responsable (MINUM) a également publié des guides, référentiels et outils pour aider à réduire l’empreinte environnementale du numérique public :
- Le guide de bonnes pratiques numérique responsable : ce document est un excellent référentiel, et aborde 9 thématiques (stratégie et gouvernance, mesure et évaluation réduction des achats, services numériques…), avec pour chacune d’entre elles des fiches de bonne pratique précisant leur niveau de priorité, la faisabilité, des exemples de pilotes, d’indicateurs de pilotage, etc.
- Le Guide pratique pour des achats numériques responsables : réalisé en collaboration avec plusieurs organisations dont la DINUM, il contient des fiches pratiques pour chaque famille d’achat, des informations sur les différents processus de labellisation et les écolabels.
- Le Référentiel général d’écoconception de services numériques (RGESN) : ce référentiel vise à pouvoir réaliser des audits sur des services numériques, et rejoint les autres référentiels et règlements existants comme le RGAA pour l’accessibilité, le RGS pour la sécurité ou le RGI pour l’interopérabilité. Il est composé de 80 critères classés en 8 thématiques, basés sur les travaux de l’Institut du Numérique Responsable.
Pour initier leur démarche, les collectivités peuvent également faire passer le MOOC Numérique Responsable de l’INR aux agents qui sont intéressés, ou encore signer la charte NR pour s’engager dans cette direction. Envie d’aller plus loin ? Il est également possible de vous faire labelliser !
Des collectivités déjà engagées
Le numérique responsable est encore un sujet en cours de défrichage par les collectivités territoriales. Malgré tout, certaines d’entre elles ont initié une réflexion sur les enjeux, les constats, et les manières d’agir.
Citons tout d’abord la Région Bretagne, qui a obtenu son label Numérique Responsable début 2021. Elle a publié son plan d’action, composé de 20 actions qui seront mises en place dans les 3 prochaines années, et qui concernent la stratégie (participation à un collège national de l’Institut du Numérique Responsable, mesure et suivi de l’empreinte environnementale), la communication et l’acculturation (animation sur le territoire, plan de communication externe), et la technique (guide de référence matériel NR, monitoring technique et environnemental des postes de travail, etc.)
La Métropole de Rennes a adopté sa charte pour un numérique responsable en mars dernier. Il s’agit d’un document de 20 pages qui décrit les enjeux et la stratégie de la métropole sur 6 thématiques : l’écologie et l’environnement, le social, la démocratie et l’éthique, le développement économique et d’usage, la gouvernance et l’équilibre territorial, la qualité du service public. Ainsi, Rennes s’inscrit dans la droite ligne d’un numérique durable, dans le sens systémique donné à ce dernier qualificatif. Par ailleurs, une première feuille de route y a été associée pour concrétiser ces ambitions, avec la mise en place d’actions telles qu’un projet de supervision et télégestion, la labellisation au label NR, ou encore la mise en place du conseil citoyen du numérique responsable.
La Rochelle est également un acteur prépondérant sur ce sujet. Membre fondateur de l’INR, signataire de la charte NR, l’agglomération n’a pas réalisé de stratégie mais a déjà réalisé son bilan carbone, qui inclut les services informatiques et d’information des collectivités et leurs prestataires externes, ainsi que les écoles de La Rochelle. Le résultat était de 680 T CO2 EQ / an, donc 54% portaient sur la fabrication du matériel, 36% sur les abonnements, prestations et consommables, et les 10% restants sur d’autres postes.
3, 2, 1, partez !
En synthèse, le numérique responsable est passé du temps des constats à celui de la réglementation et de l’action. Les administrations publiques, plus encore que d’autres organisations, ont un rôle à jouer pour elles-mêmes, mais également pour être des exemples pour tout leur territoire et provoquer des effets d’entraînement vertueux. Pour cela, elles vont devoir mesurer leur impact, et mettre en place une série de mesures pour le contrôler et le faire baisser.
Mais cela ne va pas se faire tout seul. Elles auront besoin de compétences, de méthodologie, et d’agents en charge de cette thématique, pour l’embarquer au sein de toute l’organisation et avoir un réel impact, à la manière d’un RSSI sur le sujet de la sécurité, ou d’un DPD sur celui de la protection des données personnelles.
Nous pouvons ainsi imaginer, d’ici quelques années, l’apparition des postes de DNR (Délégué au Numérique Responsable, cf. le responsable « Green IT » dans la nomenclature Cigref), qui auront pour mission de suivre et faire baisser l’impact environnemental du numérique de l’organisation, en étant un interlocuteur transversal entre DSI, direction des achats, de l’environnement, etc.
Ils pourront également être sollicités en amont des projets afin de donner leur avis sur l’opportunité de sa mise en place, par exemple pour des projets de territoires intelligents, et pourront être force de proposition sur des alternatives moins nocives pour l’environnement et les sociétés.
Nous ne sommes donc qu’au début d’un long chemin, celui de la prise en compte des externalités négatives de nos actes sur l’environnement, mais que nous devons parcourir en sprint, étant donné le caractère d’urgence auquel nous faisons face.

Julien Hautemaniere
Consultant en stratégie numérique